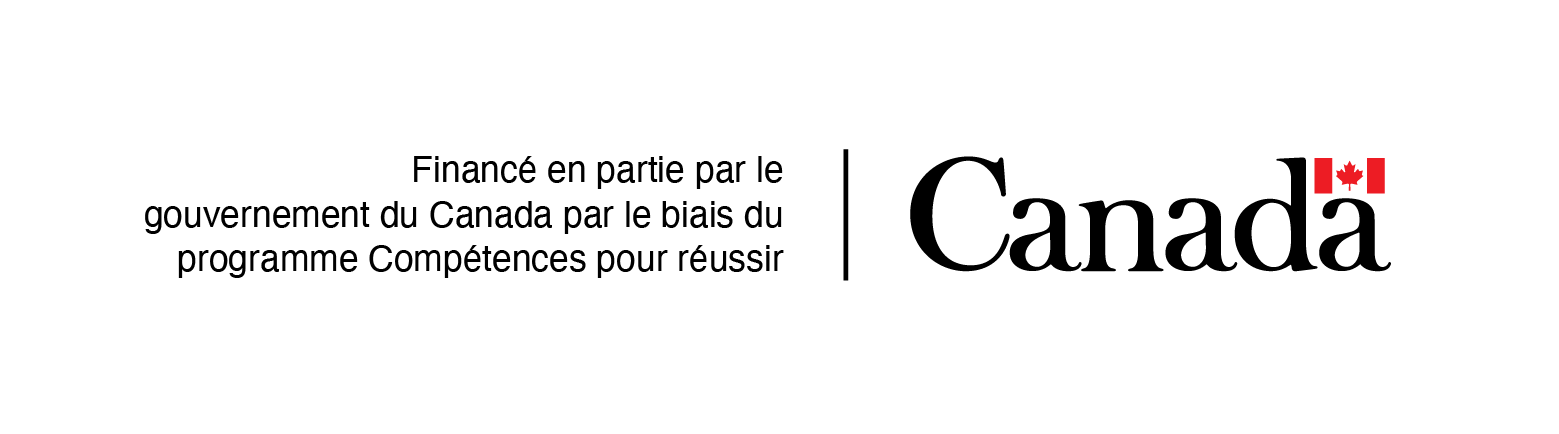L’IA en éducation : comment bien réussir son implantation ?

Vous serez sans doute d’accord avec nous que l’intelligence artificielle suscite un véritable engouement. Cependant, sa mise en œuvre concrète dans les milieux professionnels, et particulièrement en éducation, exige bien plus qu’un simple intérêt. Elle requiert une planification rigoureuse, un accompagnement soutenu et une vision à long terme.
Dans le cadre de notre balado « IA : Innovation & Apprentissage », nous avons eu le privilège d’échanger avec Carolanne Tremblay, gestionnaire de produits IA chez SkyTech. Depuis plus de 25 ans, SkyTech se distingue par des solutions technologiques créatives et conviviales, telles que Clara, Léa et Omnivox, qui ont profondément transformé les pratiques et les communications dans le monde de l’enseignement. De ce fait, cet article donne la parole à l’expérience : celle qui se construit dans le doute, les essais et erreurs ainsi que les réalités du terrain. Une exploration lucide et ancrée dans le concret, loin des discours théoriques.
Pourquoi cette ruée vers l’IA dans le secteur de l’éducation ?
C’est la grande question ! Comme l’a souligné Carolanne, et ce sans détour : la pression vient de toutes parts. De la société, mais aussi des étudiants eux-mêmes ! Il faut se rendre à l’évidence, les jeunes utilisent déjà ChatGPT et d’autres outils du même genre. Les établissements n’ont donc plus vraiment le choix. Pour rester pertinents, ils doivent comprendre ce que ces technologies permettent et ils doivent s’adapter.
Mais au-delà de l’effet de mode, il y a des besoins très concrets tels qu’alléger la charge administrative, détecter plus tôt les élèves à risque, personnaliser l’accompagnement, et surtout, libérer du temps pour que les humains puissent faire ce qu’ils font de mieux : créer des liens.
Les outils qui soutiennent l’innovation pédagogique
Si l’intégration de l’IA en éducation suscite autant d’intérêt, c’est aussi parce qu’elle commence à livrer des résultats tangibles. Certaines solutions sont déjà en place dans les établissements, d’autres en sont encore au stade expérimental. En revanche, elles ont toutes un point commun : elles visent à soutenir les humains, et non pas à les remplacer.
Voici quelques outils qui transforment (ou promettent de transformer) le quotidien éducatif :
Correction automatisée
- Pour les enseignants surchargés, notamment en français ou en sciences, la correction automatisée ouvre des perspectives intéressantes. Des outils comme Akindi développé au Canada, permettent de corriger rapidement les examens tout en laissant aux enseignants la latitude de porter un jugement pédagogique sur les cas plus complexes. Une façon concrète de récupérer du temps et de l’énergie.
Agents de dialogue pédagogiques
- Les agents conversationnels (appelés chatbot en anglais) trouvent aussi leur place dans les environnements éducatifs. Alloprof, un agent de dialogue québécois, oriente les élèves vers des ressources précises, sans qu’ils aient à naviguer longuement sur un site Web.
- Ali, quant à lui, va plus loin en combinant soutien académique et outils de gestion du stress pour renforcer l’engagement étudiant.
Analyse prédictive
- L’analyse de données appliquée à la réussite scolaire devient un véritable levier d’intervention. Des solutions comme DALIA emploient l’intelligence artificielle, en s’appuyant sur des indicateurs variés, pour identifier les risques d’échec ou d’abandon. L’objectif est de détecter les signaux et agir avant qu’il ne soit trop tard.
Au-delà de la technologie, l’essentiel demeure le temps utilisé à meilleur escient. En effet, l’IA, bien exploitée, permet surtout de libérer du temps pour accompagner, écouter et créer du lien.
L’intégration de l’IA : une question de culture, pas seulement de code
Contrairement à ce que nous pourrons penser, ce n’est pas la technologie qui fait obstacle, mais l’humain ! Carolanne Tremblay a insisté à plusieurs reprises : « l’éducation repose avant tout sur la relation. » Le véritable défi consiste à trouver les domaines où l’IA peut vraiment apporter un soutien, sans donner l’impression de remplacer l’enseignant ou l’intervenant. Il est essentiel de rassurer, d’expliquer, de dialoguer, et surtout, d’éviter le syndrome du projet « top-down » qui tombe du ciel sans consultation préalable.
« Si tu veux changer les choses, il faut que tu communiques beaucoup. Et il faut que ça communique dans les deux sens. Les craintes sont réelles, il faut les entendre. »
Un autre obstacle c’est que les enseignants sont déjà surchargés. Leur demander de consacrer des heures à l’apprentissage d’un nouvel outil, même si celui-ci peut leur faire gagner du temps à long terme, reste un pari risqué. L’implication doit être collective, de la direction aux utilisateurs finaux, avec un espace dédié à la formation et la libre expression des préoccupations.
Bonnes pratiques pour une implantation qui tient la route
L’intégration de l’IA dans une organisation peut rapidement se transformer en succès si elle est accompagnée de bonnes pratiques. Voici quelques principes clés pour une adhésion facile, qui évite les pièges classiques et garantit une expérience bénéfique pour tous :
- Impliquer toute l’équipe : Pas de projet imposé du haut de la hiérarchie ! Plus les équipes sont investies dès le choix et la création de l’outil, plus l’adoption devient naturelle et fluide. Il est crucial que chacun se sente comme un acteur du changement.
- Adapter l’outil aux pratiques, pas l’inverse : L’outil doit s’adapter aux besoins et pratiques locales. Collaborez avec des développeurs qui acceptent de personnaliser le système en fonction de ces besoins. Exigez un accompagnement à votre image lors du déploiement pour éviter toute résistance au changement.
- Former et accompagner : Il est essentiel de prendre le temps d’expliquer, de rassurer et de répondre aux préoccupations. Les experts internes, qui connaissent bien les spécificités de l’organisation, sont souvent les mieux placés pour démystifier l’IA auprès de leurs collègues et rendre la transition plus douce.
- Communication transparente : Créez des espaces ouverts de discussion où les craintes peuvent être exprimées et abordées en toute transparence. Ignorer ou minimiser les inquiétudes peut nuire à l’adhésion du personnel et ralentir le processus d’intégration.
L’inclusion : un enjeu à double tranchant
Pour les communautés francophones en situation minoritaire, l’intelligence artificielle représente à la fois une opportunité et un risque. Nous en avions d’ailleurs parlé avec Marie Andrée Dion-Gauvin, conseillère technopédagogique chez Collecto lors de notre premier épisode. De nombreux outils sont développés ailleurs, dans des contextes culturels et linguistiques différents, ce qui peut introduire des biais et marginaliser certaines réalités locales.
Notre invitée chez SkyTech est du même avis. Il est crucial de privilégier des outils conçus localement ou du moins soigneusement adaptés afin de préserver les spécificités culturelles et linguistiques. Les communautés qui prennent l’initiative de développer ou de personnaliser leurs propres solutions seront toujours mieux servies que celles qui attendent que le marché global réponde à leurs besoins.
Conclusion
L’implantation d’un outil d’IA en éducation ne consiste pas simplement à ajouter un gadget dans un secteur mature. C’est d’abord repenser les pratiques, écouter les humains et adapter la technologie aux réalités du terrain. Et surtout, garder le cap sur ce qui compte vraiment, c’est-à-dire l’apprentissage, le lien et la diversité !
Comme le rappelle Carolanne Tremblay, il faut s’informer, débattre, et surtout, ne jamais perdre de vue que l’IA doit rester un outil au service de l’humain et jamais l’inverse.
Pour découvrir notre entrevue en entier avec Carolanne Tremblay, écoutez l’épisode #4 de notre balado !